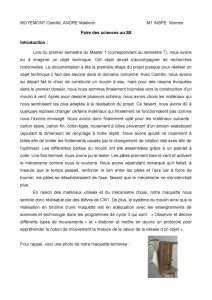Présentation de l’objet
Notre moulin fait 20 cm de haut, avec des pales de 30 cm de diamètre. Nous avons choisi de faire des pales sur le modèle des moulins pour enfant, c’est-à-dire par pliage. Il est constitué de carton fin (boîte de carton alimentaire), de carton épais (du type carton de déménagement), de colle chaude, de bâtons de coton-tige et enfin de roulement à billes provenant d’un ancien skate. Il possède une base carrée de 15 cm de côté. Le mouvement rotatif des pales est transmis par un engrenage, composé d’une roue dentée verticale et d’une autre horizontale. La première est fixée sur l’axe soutenant les pales, alors que la seconde est collée sur un axe parcourant verticalement le moulin du plafond jusqu’à la meule dormante. Ces deux axes sont supportés par des roulements à bille. Les meules mouvantes sont debout, pour que celles-ci aient plus de facilité à tourner. Le toit qui soutient la roue dentée horizontale est en carton épais pour pas qu’il se plie sous le poids du roulement à billes et de la roue dentée .
Concepts scientifiques abordés lors du projet
Une des pièces essentielles de l’objet est la roue à vent. Cette partie du mécanisme est la plus visible car elle est bien exposée à la vue et parce qu’elle est très grande par rapport à l’ensemble du moulin. C’est la partie la plus importante de cette machine, car c’est le capteur de vent et le premier maillon de la chaîne de transmission de mouvement. Sa fonction principale est de transformer la force du vent. Toujours face au vent, la surface de l’écran reçoit toutes les rafales de vent. L’éolienne forme une croix à plusieurs bras, généralement en nombre égal, c’est la tradition qu’il voulait avoir de l’équilibre. Habituellement à quatre bras, il y en a aussi avec six et même huit bras.
Le mécanisme est compliqué car il faut transformer un mouvement de rotation verticale en un mouvement de rotation horizontale. Pour cela, plusieurs pièces sont nécessaires.
Le long de l’axe de la roue, est fixée une grande roue en bois armée de dents: c’est le rouet. Cette roue dentée est le lien le plus compliqué et le plus élaboré de tout le système de transmission de mouvement. Depuis l’invention de la fonderie, cette pièce est généralement en fonte. Le rouet est généralement renforcé du côté opposé aux dents. Les dents sont nommées “alluchons”. Le centre du mécanisme de transmission est le point de contact entre les deux engrenages. C’est une articulation vulnérable en raison des forces impliquées et de la nature des surfaces qui se frottent les unes contre les autres. Les dents, mieux appelées ici les alluchons, sont les parties qui traversent et transmettent la plus grande concentration d’effort.
Ensuite nous trouvons le pignon. C’est la partie la plus puissante de tout le système de transmission de mouvement et elle subit la pire méthode de traitement. Le pignon doit en effet résister à l’impact violent du vent, et il doit le faire souvent et pendant longtemps. Cette roue est très petite par rapport à la taille du rouet. Il est placé horizontalement sous l’arbre principal. Son axe est vertical et se situe exactement au centre géométrique du cercle formé par le chemin de sommeil. Par conséquent, lorsque le meunier fait tourner le moulin pour l’orienter dans le vent, le rouet et l’arbre principal tournent également ensemble. Il est essentiel que ce mouvement de rotation autour de l’arbre de pignon n’affecte en rien le contact entre les deux engrenages.
Une pièce indispensable pour la moulange est le gros fer de meule. C’est la liaison rigide entre la lanterne et la meule mobile. Il s’agit d’une tige solide en métal, en fer ou en acier de section carrée en position verticale, dont l’extrémité supérieure est intégrée au pignon et le traverse. Le fond du gros fer de meule s’insère dans l’anille, morceau de métal attaché à la roue mobile et qui sert à contrôler son mouvement de rotation. L’anille, la meule mouvante et la balance sont transportées par le petit fer de la meule.
Il faut désormais se pencher sur l’aspect physique du fonctionnement d’un moulin à vent.
Le vent est le mouvement de l’air. Le mouvement de la roue est engendré par la pression du vent sur les ailes. Cette pression peut se calculer avec la formule suivante: p = A x v². P est la pression, A la surface sur laquelle le vent souffle et v la vitesse de ce vent. Cette pression du vent sur les ailes crée alors une énergie car on constate une relation unissant force, bénéfice et vitesse. L’énergie E se calcule avec : A x v3 x t. Autrement dit, l’énergie est égale au produit de la surface sur laquelle le vent souffle par la sa vitesse du vent au cube ainsi que le temps durant lequel celui-ci souffle. Lors de la transmission du mouvement de la première roue dentée à la deuxième, on observe une perte d’énergie due aux frottement des dents. Cependant dans notre objet, cette perte d’énergie sera moindre (inobservable) étant donné que les deux roues sont de la même taille.
Pour résumer, le vent, en soufflant sur les pales va enclencher une rotation de ces dernières qui vont elles-mêmes faire tourner l’axe. Au bout de cet axe se situe la première roue dentée. Cette roue dentée va donc tourner et va permettre d’actionner via le frottement des dents la seconde roue se trouvant perpendiculaire à la première. C’est à ce moment que s’opère la translation de la rotation verticale à la rotation horizontale. La deuxième roue va entraîner la rotation de son axe qui, au bout, permet au roulement à bille de tourner à son tour.
Transférabilité
Sachant que la fabrication doit tout de même être minutieuse, alors elle peut être proposée à des élèves de cycle 3. De plus, le travail sur les énergies se fait lors du cycle 3. Ce projet permet aussi de pratiquer des démarches scientifiques et technologiques, car les élèves devront répondre à une question générale sur l’énergie et les transmissions nécessaires pour créer ce moulin.
Il permet aussi d’observer et de décrire différents types de mouvements présents sur cet objet technique.
De plus, en cycle 3, les élèves apprennent à utiliser des instruments de géométrie. Donc grâce à ce type de construction, les élèves pourront utiliser ces outils de façon concrète.
Trucs et astuces pour la réalisation du moulin
Le principal écueil est de mal préparer les roues dentées des engrenages. Ce sont les parties les plus minutieuses à fabriquer. Ce seront sûrement les pièces les plus compliquées à faire car les dents doivent être parfaitement alignées pour que l’engrenage puisse tourner et perdre le moins d’énergie durant les transmissions. Les positions des dents devront être construites grâce à un compas, de façon très précise.
Ensuite les dents ne doivent ni être trop longues, car la transition entre les roues dentées sera difficile, ni trop courtes, car l’engrenage pourrait sauter des dents et donc perdre de l’énergie.
Pour la formation des pales, nous recommandons de faire des pâles faites avec une technique d’origami. Elles ressembleront aux moulins à vent sur une tige pour enfant.
Puis, sachant qu’une grande partie de la perte d’énergie se fait au niveau de la friction des axes dans les trous prévus pour leur passage. Le mieux serait de recycler des anciens roulements à billes. Mais si c’est impossible le mieux est créer un trou à peine plus large que l’axe, mais pas trop large car l’axe doit tout de même être maintenu.
Proposition de séquence :