L’école d’autrefois

Redoublement, punitions, devoirs mal vus….L’école de nos grand-parents était très différente de celle que nous connaissons aujourd’hui.
Elle se voulait plus sévère, non collective, exclusive des élèves n’arrivant pas à suivre. Le professeur avait la place centrale et dispensait des cours magistraux.
La relation avec les parents était plutôt bonne ; les mots clés de l’éducation à l’école ou à la maison étaient « discipline » et « rigueur ».
Mai 1968 marque une rupture avec le conformisme ambiant, ainsi, la révolution est présente aussi bien dans la société que sur les bancs de l’École….
Les pédagogies alternatives, une solution ?
L’arrivée de ce nouvel élan marque l’émergence d’autres pédagogies qui sont cette fois centrées sur l’enfant et son bien-être.

Des pédagogies méconnues du grand public font alors leur apparition. Maria Montessori, médecin et pédagogue, tentait pourtant dès le début du 20 ème siècle de se faire une place dans le monde de l’éducation.
Elle se consacra à l’éducation des enfants « retardés mentaux » avant d’étendre sa pédagogie aux autres enfants et fonda son école à Rome en 1907.
Sa devise : « Aide-moi à faire seul ».
Cette pédagogie est fondée sur la volonté d’aider l’enfant à se construire et à développer son autonomie à partir de l’observation de ses rythmes de développement.
La méthode Montessori met à profit ces périodes pour aider le jeune enfant à découvrir par lui même des connaissances et des expériences nouvelles en utilisant tous ces sens.

En 1964 une certaine école dites « école Freinet » est reconnue officiellement comme « école expérimentale ». Celle-ci est basée sur les travaux du pédagogue Célestin Freinet qui ancre sa réflexion sur le respect des rythmes et des centres d’intérêts de l’enfant.Pour lui, le savoir et l’apprentissage doivent s’encrer dans le vécu et la vie de l’enfant pour avoir un sens et pour être compris et retenu par lui.
Tous les modèles de pédagogies alternatives ont emprunté à la pédagogie de Freinet. Et même si la mise en œuvre de cette pédagogie à conduit certaines écoles à explorer d’autres voies que certains ont qualifié de dérives, elle n’en reste pas moins d’actualité.

Jean Piaget est né en Suisse en 1896. Sa pédagogie est basée sur ses travaux sur les stades de développement de l’intelligence chez les enfants.
Piaget souhaite que les enfants apprennent par l’expérience autour d’ activités diverses et concrètes.
Piaget a identifié 4 stades caractérisant la construction de l’intelligence :
- -Le stade sensori-moteur : de la naissance à 2 ans, l’enfant acquiert la maîtrise de sa motricité la connaissance des objets physiques
- -Le stade puéril : de 3 à 7 ans, caractérisé par l’égocentrisme
- -Le stade opérationnel concret : de 7 à 12 ans, l’enfant découvre la conceptualisation abstraite (calcul)
- -Le stade opérationnel formel : de 12 à 15 ans, l’enfant acquiert le raisonnement logique systématique.
Les travaux de Piaget ont très largement influencé l’éducation, même si ses théories sont actuellement remises en cause par les découvertes et évolutions de la psychologie.
Les trois exemples donnés tentent de nous prouver que l’enfant est un individu à part, un être singulier puisqu’il a sa propre façon d’interpréter le monde. Ces pédagogies se basent sur par la coopération, la prise en compte du niveau scolaire et des intérêts personnels de chaque enfant. L’élève est au centre des apprentissage et gagne en autonomie.
Ces grands élans pédagogiques sont (aujourd’hui) le crédo de plusieurs écoles hors contrat qui garantissent aux parents un lieu d’épanouissement pour leurs enfants. Si certains suivent les programmes et ressemblent à une école dite « classique », d’autres laissent les enfants venir aux savoirs quand ils le souhaitent… Ce nouvel élan n’a bien sur pas échappé à la toile et les vidéos et articles prônant les bienfaits des pédagogies alternatives fleurissent sur le web.
Source : youtube. « Écoles alternatives : une voie à suivre ? – Tout Compte Fait »
Toutes ces initiatives ne vous rappellent rien ? Mais si… L’éducation Nationale !
L’école aujourd’hui…
L’éducation nationale inspirée !
Avec les années l’école est devenue moins punitive, plus axée sur les échanges collectifs, l’élève est désormais au cœur de ses apprentissages.
L’éducation Nationale prend en compte les nouveaux défis sociétaux. On le constate dans les programmes : matière transversale, donner du sens aux enseignements, école bienveillante… Et si vous ne nous croyez toujours pas, voici un outil fortement utilisé pour prendre en compte les différences. Tadam : la différenciation pédagogique.
Sous ces deux petits mots se cachent un véritable objectif, rendre l’apprentissage et la réussite accessible à tous. Toujours pas convaincu ? Pourtant, cette démarche est très souvent sollicitée par les enseignants car les élèves n’ont pas le même rythme d’apprentissage (tiens, j’ai déjà entendu cela quelque part …). L’objectif de cette démarche est de mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens et de procédures pour rompre avec la pédagogie « frontale » soit la même leçon, les mêmes exercices pour tous et au même moment.
http://https://www.youtube.com/watch?v=rEgJYAFsNu8
Source : youtube.com
Plus d’infos sur la différenciation sur : http://blog.espe-bretagne.fr/prodm1vannes/comment-differencier-oui-mais-comment/
Les nouvelles façon appréhender l’apprentissage et l’éducation des enfants sont de plus en plus nombreuses dans nos écoles. Les recherches en en neurosciences, l’émergence du numérique ne font qu’accélérer le processus de transformation.
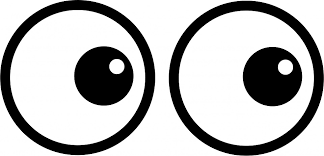


Bonjour,
Quelle était la formation des maîtres autrefois?
Bonjour Chloé, nous espérons que tu nous pardonneras ce long temps de réponse mais nous devions nous pencher sur la question car elle nécessitait des recherches complémentaires.
En 1833, la loi GUIZOT crée les Écoles normales de garçons et stipule : « Tout département sera tenu d’entretenir une École normale primaire soit par lui-même soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins.»
En 1879, deux Écoles Normales sont obligatoires dans chaque département : une pour les instituteurs et une pour les institutrices.
En 1920, l’enseignement doit être expérimental : pas de discours, pas d’enseignement livresque mais des observations et expériences.
En 1940, un recrutement par concours annuel est mis en place, les candidats reçus entrent ensuite en classe de seconde aux lycées et collèges comme boursier, une fois leur baccalauréat obtenu, ils reçoivent un an de formation professionnelle.
En 1969, la formation post-bac passe à deux ans, avec un droit d’accès à des cours en faculté.
En 1979, est créé le DEUG mention « enseignement du premier degré »
En 1989, la Loi Jospin d’orientation sur l’éducation induit la création d’un Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) dans chaque académie et organise le recrutement au niveau bac + 3 qui est suivi d’une année année professionnelle en IUFM.
C’est la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 qui prévoit la suppression des IUFM qui cèdent leur place aux Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation le 1er septembre 2013.
Pour plus de détails, tu peux te référer aux sites ci-dessous :
Histoire de la formation des enseignants – Site ESPE de l’académie de Créteil
La formation des professeurs des écoles avant 1914 – Persée
Regards sur la formation des maitres en France – Journal Open édition
Le développement des écoles primaires à la fin du 19e – L’histoire par l’image
Selon vous, l’école va-t-elle encore évoluer ?
Bonjour Lucie !
L’évolution est inévitable pour l’École puisqu’elle est une micro-société, par conséquent, si la société évolue l’École en fait de même.
Actuellement, l’École doit évoluer pour répondre aux nouvelles problématiques de notre société. Elle prend en compte notamment les nouvelles expériences qu’offrent le numérique : les réseaux sociaux et le cyberharcèlement, les TBI, les classes mobiles,l’apprentissage du code informatique…
Face à l’augmentation des étrangers et par conséquent des allophones, l’École s’adapte, elle différentie, elle écoute, elle réfléchit à de nouvelles solutions.
Depuis la loi sur le handicap en 2005, l’École continue de s’adapter, de prendre en considération ces personnes qui étaient jusque là exclues du système éducatif dit classique.
Par ailleurs, l’École se base sur les avancées de la neuroscience pour évoluer, elle prend en compte les travaux sur le développement et le cerveau de l’enfant.
Enfin, il est important de rappeler que l’École est une institution de la République ; elle dépend du ministère de l’Éducation en place et évolue donc à chaque changement de ministère.